| |
|
|
Léon, Jacqueline, Histoire de l'automatisation des sciences du langage, Lyon, ENS éditions, 2015, 218 p., ISBN 978-2-84788-653-5, prix : 19 euros.
Cet ouvrage, consacré à l'histoire de l'automatisation mathématisation des sciences du langage, se situe en histoire et épistémologie des sciences du langage. Il s'inscrit dans l’histoire du récent. Deux moments sont distingués : la traduction automatique dans les années 1950, et les études sur corpus informatisés dans les années 1990 avec le développement inédit des ordinateurs. La traduction automatique, issue des sciences de la guerre, a été conçue comme technologie de guerre froide aux États-Unis pour fournir des traductions en série des travaux soviétiques. Elle a été conçue en dehors de la linguistique. L’ouvrage s’attache à montrer, selon une approche comparative, comment les sciences du langage ont intégré cette technologie pour amorcer leur automatisation. Cette intégration revêt diverses formes selon les traditions culturelles et linguistiques des pays impliqués (États-Unis, ex-URSS, Grande-Bretagne et France). Les études sur corpus au contraire se situent dans la continuité de thématiques familières aux sciences du langage, notamment l’étude des textes, écrits et oraux, et du lexique. Informations complémentaires :
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100891390
|
 |
Benveniste, Emile, Langues, cultures, religions, Edition et introduction de Chloé Laplantine et Georges-Jean Pinault, Limoges, Lambert-Lucas, 2015, 380 p., ISBN 978-2-35935-099-9, prix : 30 euros.
Émile Benveniste a longtemps partagé son temps entre le Collège de France, où son cours a donné naissance aux articles des Problèmes de linguistique générale I et II (1966 et 1974), et l’École Pratique des Hautes Études, où son cours a donné naissance aux articles ici réunis… Frédéric Deloffre disait en 68 : « Je ne comprends pas cette histoire de linguistique générale. Existe-t-il une langue générale, dont on pourrait faire la science ? Non, il n’existe que des langues particulières, dont on ne peut faire que des linguistiques particulières. » C’est de ces linguistiques particulières que parlent les 34 articles (1930-1968) recueillis dans le présent volume. Table des matières
|
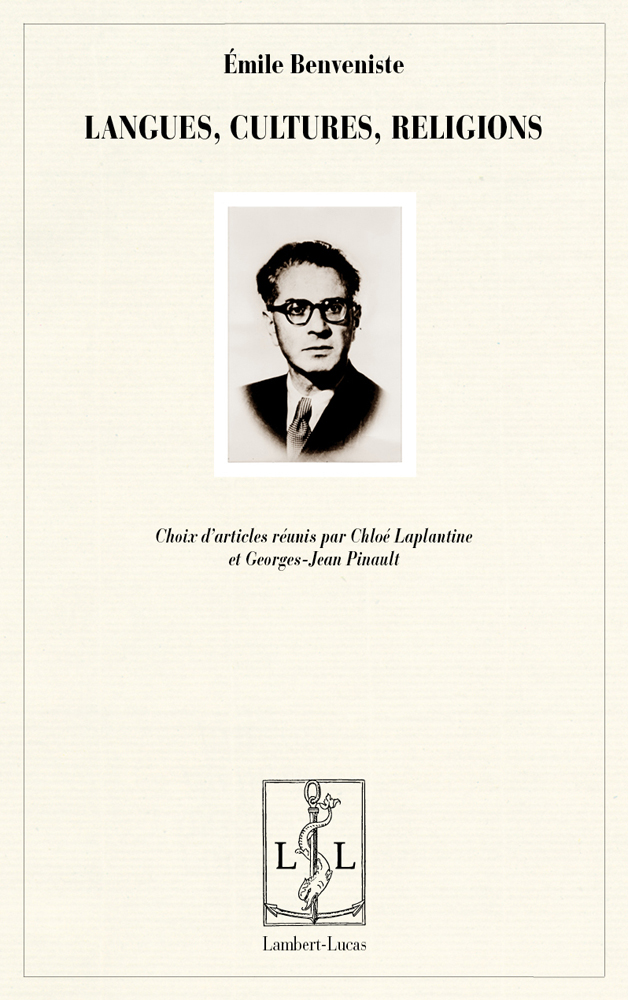 |
Bédouret-Larraburu, Sandrine & Chloé Laplantine (eds), Emile Benveniste : vers une poétique générale. Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, collection Linguiste et littérature 2, 2015, 234 p., ISBN 2353110592, prix : 20 euros.
Émile Benveniste (1902-1976), grand linguiste français du xxe siècle, spécialiste avant tout du domaine indo-européen et auteur d’une linguistique générale qui reste un fondement pour la réflexion sur le langage et les langues, s’est intéressé toute sa vie au langage poétique. Cet intérêt apparaît ponctuellement dans ses travaux sur le langage, les langues et cultures ou encore dans quelques textes plus « littéraires ». Ses travaux de linguistique générale ouvrent déjà, en eux-mêmes, sur le problème du langage poétique, et permettent de faire du poème un champ de réflexion possible pour le linguiste. On sait maintenant, grâce à la publication de ses manuscrits sur « la langue de Baudelaire », qu’il avait engagé l’écriture d’un important travail critique sur cette question : « La théorie de la langue poétique est encore à venir . Le présent essai a pour but d’en hâter un peu l’avènement ».
Ce volume cherche à mettre en regard les travaux inachevés, parvenus jusqu’à nous sous forme de notes manuscrites, avec les Problèmes de linguistique générale. Il constitue les actes du colloque « Émile Benveniste et la littérature » qui s’est tenu en avril 2013 à Bayonne. Les contributions rassemblées ici questionnent de manières diverses le rapport d’un linguiste avec le langage poétique, ses méthodes d’investigation, ses préoccupations terminologiques, et poursuivent en même temps, avec lui, la recherche actuelle d’une poétique.
|
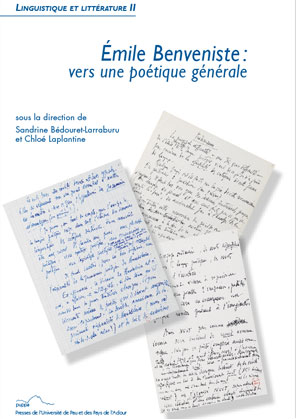
|
Barton, Johan, Donait françois, édition de Bernard Colombat, Paris, Classiques Garnier, 2014, 223 p., ISBN 9782812428449, prix : 32 euros.
Le Donait français est considéré comme la première grammaire française. Destiné à apprendre aux Anglais le «doux français» de Paris, il est en fait rédigé en anglo-normand. Il traite successivement, des lettres et des règles phonétiques, des «accidents» des parties du discours, et des parties du discours.
Table des matières http://www.classiques-garnier.com/editions-tabmats/BcaMS01_tabmat.pdf
|

|
Mauger, Claude, Grammaire françoise. French Grammar, édition de Valérie Raby, Paris, Classiques Garnier, Série Grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles 1, 2014, 651 p., ISBN 978-2-8124-2853-1 (br.), prix : 59 euros.
La Grammaire françoise de Claude Mauger est un des manuels de français langue étrangère les plus diffusés du 17e siècle. Cet ouvrage composite est exemplaire du type d’objets techniques alors conçus pour délivrer l’ensemble des savoirs linguistiques utiles à la maîtrise du français. Table des matières en ligne
|

|
Archaimbault, Sylvie, Jean-Marie Fournier & Valérie Raby, eds., Penser l'histoire des savoirs linguistiques. Hommage à Sylvain Auroux, Lyon, ENS éditions, 2014, coll.: Langages, 716 p., ISBN 9782847884173, prix : 29 euros.
L'ouvrage dresse l’état des lieux d’un domaine de recherches, celui de l’histoire et de l’épistémologie de la linguistique, qui s’est fortement développé depuis ces trente dernières années. Une cinquantaine d’articles variés, dédiés à des langues comme à des périodes diverses, sont ici réunis dans un hommage à Sylvain Auroux, philosophe et historien des sciences du langage, qui a construit l’armature tout à la fois intellectuelle, méthodologique et institutionnelle de ce champ. Au-delà des informations précises ici rassemblées, le lecteur trouvera également l’occasion de réfléchir à la place de la linguistique dans les sciences humaines, et dans les sciences en général.
Préambule
Publications de Sylvain Auroux
Note éditoriale : Sylvain Auroux et la collection Langages, bilan et perspectives • B. Colombat
L'externalisme appliqué : penser, construire • J. Deschamps
Première partie. Histoire, épistémologie, langage
L'invention linguistique de la « préhistoire » • C. Blanckaert
Esquisse d'une lecture kuhnienne de l’histoire de la tradition grammaticale arabe • D. Kouloughli
À quoi bon l’histoire ? Aporie des frontières et illusions monistes • D. Samain
Histoire, philosophie, langage : le problème de l’intentionnalité • J. Guilhaumou
Le seuil du langage. Intersections épistémologiques à l’époque du comparatisme • L. Formigari
Localisme et théorie des cas • J.-M. Fortis
Positivismes et positivité en linguistique • C. Puech
Language in its own image: on epilinguistic and metalinguistic knowledge • T. J. Taylor
La linguistique de l’écouteur entre cerveau et esprit : une stratégie pour un futur prochain • F. Albano Leoni
Sur la « grammaire publique » du sujet parlant • F. Lo Piparo
Catégorisation et conceptualisation : « évidentialité » et médiativité • Z. Guentchéva
Mathématiser et formaliser les concepts de la linguistique • J.-P. Desclés
La « perpétuité » de la langue française : horizon de rétrospection et horizon de projection • H. Merlin-Kajman
La contribution des bases de données spécialisées à la recherche en histoire des théories linguistiques : deux exemples • B. Colombat
D’une « Corse » à l’autre : quelques étapes d’un parcours de Sylvain Auroux • S. Fisher
Deuxième partie. Grammatisations, outillages et descriptions des langues
Les langues du continent africain : les avatars d’une classification • E. Bonvini
Signes et idées dans deux traditions : la Chine dans les théories linguistiques des Lumières et les Lumières en Chine • G. Hassler
Snapshots of the Tamil scholarly tradition • J.-L. Chevillard
Les grammairiens indiens du sanskrit et le sens des mots • É. Aussant
Les gloses en yiddish ancien, de la lexicographie à la grammaire • J. Baumgarten
Ibn Khaldoun et la question de l’historicité de la tradition grammaticale arabe • J.-P. Guillaume
Principes et pratiques dans la conception politique de la langue en France au XVIIe siècle • D. A. Kibbee
« Nous sommes plus exacts en nostre langue, & en nostre stile, que les Latins » : la représentation du latin chez les remarqueurs français au XVIIe siècle • W. Ayres-Bennett
Retour sur la grammatisation : l’extension de la grammaire latine et la description des langues vulgaires • J.-M. Fournier et V. Raby
Outils et boites à outils pour « la langue française » • F. Mazière
L’organisation des grammaires françaises et l’étude de la forme des mots dans la première moitié du XIXe siècle • B. Bouard
Disciplinarisation et outillage de l’espace linguistique en France, 1875-1925 • C. Klippi
Tratamiento de la sintaxis en gramáticas españolas del último tercio del siglo XVIII • J. J. Gómez Asencio
La sintaxis española del siglo XVIII : entre la tradición y la modernidad • R. Sarmiento
The Doctrine of the Particles in Early Modern English Grammar • D. Cram
La enseñanza de las primeras letras en la puesta en marcha de un sistema estatal moderno: el Método de lectura gradual (Valparaíso, 1845) de Domingo Faustino Sarmiento • E. N. de Arnoux
Hacia una historia de la lingüística en la Argentina: la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana • 1930- 1949 • G. Toscano y García
Instruments linguistiques et langue nationale : un événement au Brésil au XIXe siècle • E. Guimarães
L’ordre des mots et la langue brésilienne • E. P. Orlandi
A inversão de português-tupi para tupi-português nos dicionários bilíngues • J. H. Nunes
El funcionamiento social de las tecnologías lingüísticas: Apuntes sobre la escritura en guaraní en la Provincia Jesuítica del Paraguay • C. Rodríguez-Alcalá
Troisième partie. Histoires et singularités
Deux méprises (et demie) à propos de Saint Augustin et le temps • S. Vecchio
Les Médiévaux et Port-Royal sur l’analyse de la formule de la consécration eucharistique • I. Rosier-Catach
Comment bien traduire en allemand : Schottel et la quête de la Grundrichtigkeit • C. Lecointre
Claude Buffier : examiner les préjugés, concevoir un plan nouveau • S. Delesalle
Pourquoi Humboldt ? • J. Trabant
Mixail Lomonosov, lecteur de l’Encyclopédie • S. Archaimbault
Le monde perdu de Nikolaj Marr : un philosophe du langage du XVIIIe siècle dans la Russie stalinienne • P. Sériot
Michel Bréal : mettre l’homme dans la langue • B. Nerlich
Salient scholars. Michel Bréal and his Dutch connections • J. Noordegraaf
Saussure, la syllabe, et la linéarité du signifiant • M. Dominicy
Meillet devant la linguistique contemporaine • H. Bat-Zeev Shyldkrot
La phonétique au féminin au début du XXe siècle : Louise Kaiser (1891-1973) et l’Italie • E. Galazzi
La théorie des traits distinctifs de Jakobson : transferts et convergences entre mathématiques, ingénierie et linguistique • J. Léon
Postface : Pour saluer Sylvain Auroux • J.-C. Chevalier
Annexes
Index nominum
Index rerum
Tabula gratulatoria.
|

|
Toutain, Anne-Gaëlle, La rupture saussurienne : l’espace du langage, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014, 394 p., coll. Sciences du langage : carrefours et points de vue, 11, ISBN 978-2-8061-0145-7, prix : 44 euros.
Cet ouvrage propose une lecture radicalement nouvelle de la pensée saussurienne, fondée sur la reconnaissance de la distinction entre langue et idiome instaurée par la théorie saussurienne de la langue. Cette distinction, qui a été recouverte par l’ensemble de la linguistique postsaussurienne, ouvre l’espace du langage comme espace de théorisation, et cette lecture de Saussure donne ainsi lieu à une reconsidération des rapports entre linguistique et psychanalyse ainsi que de la question de la neurolinguistique.
Table des matières en ligne
|
 |
Testenoire, Pierre-Yves, Ferdinand de Saussure à la recherche des anagrammes, Limoges, Lambert-Lucas, 2013, 350 p., ISBN 978-2-35935-048-7.
La recherche de Ferdinand de Saussure sur les anagrammes poétiques (1906-1909) a depuis sa découverte dans les années soixante alimenté des entreprises théoriques fort diverses. De Jakobson à Lacan, de Starobinski à Kristeva, de Derrida à Baudrillard, l’anagramme saussurien a connu une postérité brillante, vivace et polymorphe. La productivité du concept révèle aussi le flou dans lequel est tenu le travail saussurien. Cinquante années après les premières publications fragmentaires, il reste entouré de mystère, les textes qui le consignent demeurant dans l’ensemble inédits. Déterminer les enjeux épistémologiques de cette recherche sur la base d’une publication (F. de Saussure, Anagrammes homériques, Limoges, Lambert-Lucas, 2013), telle est l’ambition du présent ouvrage.
Historique et méthodique, l’enquête permet une analyse précise des recherches de Ferdinand de Saussure sur le texte de l’Iliade et de l’Odyssée. De nouveaux aspects de son questionnement affleurent, alors que d’autres s’enrichissent, au carrefour de la philologie, de la linguistique et de la poétique.
Url de référence : http://www.lambert-lucas.com/ferdinand-de-saussure-a-la
|
 |
Grondeux, Anne, À l'école de Cassiodore. Les figures « extravagantes » dans la tradition occidentale, Turnhout, Brepols, 2013, coll.: Corpus Christianorum Lingua Patrum (CCLP 7), 388 p., ISBN 9782503549019, prix: 170 euros HT.
L'étude des figures employées par Cassiodore dans son Expositio psalmorum et de leur postérité répond à plusieurs questions, celle de la constitution, au VIe siècle, d'une terminologie savante qui puise à des sources grecques, celle de la transmission d'une branche du savoir antique au Moyen Âge, celle enfin du rôle des figures dans l'exégèse. De même que les arts libéraux se voulaient alors au service de l'exégèse, l'histoire de ces disciplines peut en effet aujourd'hui servir à celle de l'exégèse. De Cassiodore à Lanfranc, Manegold, Anselme de Laon, Bruno le Chartreux et Pierre Lombard , l'étude de figures utilisées pour commenter l'Écriture fait apparaître les liens entre certains commentaires mediévaux, car le recours à un vocabulaire spécialisé trahit des filiations, et jette un éclairage nouveau sur certains problèmes d'attribution. Elle met aussi en lumière les sources autres qu'exégètiques auxquelles certains maîtres ont eu recours, en liaison avec les commentaires de poètes antiques enseignés dans les écoles et la grammaire de Priscien. Elle révèle une double dynamique de remploi sélectif de la terminologie antique et de renouvellement original, ainsi qu'un va-et-vient entre arts libéraux vers l'exégèse, puisque cette terminologie se trouve partiellement récupérée par les grammaires à partir du XIIe siècle.
|
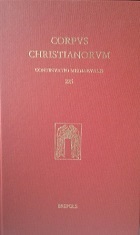 |
Saussure, Ferdinand de, Anagrammes homériques, Edition et présentation de Pierre-Yves Testenoire, préface de Daniele Gambarara, Limoges, Lambert-Lucas, 2013, 450 p., ISBN 978-2-35935-047-0, prix : 60 euros.
Ferdinand de Saussure développe en 1906 l’hypothèse d’un principe de composition des poésies anciennes : l’anagramme. Il y consacre, trois ans durant, plus d’une centaine de cahiers manuscrits sans en publier une ligne. Ces travaux, découverts dans les années soixante, ne sont connus depuis que par des extraits. Qualifiés tantôt de géniaux, tantôt de délirants, ils restent, faute de réelle édition, largement méconnus. Anagrammes homériques vient combler cette lacune. Établie selon des principes philologiques, la présente édition contient la totalité des textes connus relatifs aux anagrammes dans la poésie homérique ; elle donne pour la première fois accès à un corpus cohérent de travaux de poétique de Ferdinand de Saussure. Réunissant vingt-quatre cahiers et quelques feuillets séparés, elle permet de comprendre l’élaboration et les développements progressifs de l’hypothèse anagrammatique. L’analyse minutieuse des vers de l’Iliade et de l’Odyssée tente de saisir le travail vocal à l’œuvre dans la fusion poétique – nouveau versant de l’entreprise linguistique et poéticienne de Saussure. http://www.lambert-lucas.com/anagrammes-homeriques
|
 |
Kessler-Mesguich, Sophie, Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon (1508-1680), Avant-propos de Max Engammare, Genève, Droz, 2013, coll.: Travaux d'Humanisme et Renaissance, xiv, 314 p., ISBN 978-2-600-01641-4, prix : 60 CHF.
Sophie Kessler-Mesguich nous a quittés trop tôt, beaucoup trop tôt (8 février 2010), sans avoir eu le temps de donner la mesure de tout ce qu’elle connaissait de la grammaire historique de l’hébreu, sans avoir pu achever cette grammaire de l’hébreu moderne qui était devenue son dessein majeur. Elle n’avait jamais publié sa thèse de doctorat, soutenue le 19 décembre 1994 à l’Université de Paris VIII, voulant constamment la parfaire. Cette thèse, Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon (1510- 1685), n'a pourtant pas pris une ride et il était indispensable de la publier. Une double compétence est exigible pour quiconque souhaite étudier les grammaires de l’hébreu en France au seizième siècle : une maîtrise de l’hébreu (et de l’araméen) et une familiarité érudite du latin linguistique de la Renaissance. Sophie Kessler-Mesguich avait acquis ces deux compétences. Personne avant elle n’avait si bien présenté et analysé l’œuvre de François Tissard, la publication de son Alphabetum Hebraicum et de sa Grammatica Hebraica, ayant identifié toutes les sources de Tissard. Qui est capable de reprendre un tel travail et de nous montrer que c’est en helléniste que Tissard a approché la langue hébraïque et utilisé la grammaire de Qimhi? On peut formuler une question identique avec Sante Pagnini et ses Hebraicarum institutionum libri quatuor de 1526. Sophie Kessler-Mesguich a ainsi établi que le premier livre des Institutiones Hebraicæ est “remarquable par sa précision, tant dans la description phonétique que dans les transcriptions”. Quant au deuxième livre, consacré au nom et au pronom, l'auteur montre que Pagnini s’appuie à la fois sur le Mikhlol de David Qimhi et sur le Ma‘aseh ’Efod. Tout au long de ce livre, le spécialiste comme le débutant sont éclairés et nourris, très souvent conquis.
Le sommaire complet est disponible chez l'éditeur :
http://www.droz.org/fr/5856-9782600016414.html#/support-livre_reli%C3%A9
|
 |
Fournier, Jean-Marie, Histoire des théories du temps dans les grammaires françaises, Lyon, ENS Editions, 2013, coll.: Langages, 332 p., ISBN 978-2-84788-311-4, prix: 29 euros.
Ce livre est une monographie sur l'histoire des théories du temps grammatical dans les grammaires françaises composées entre le XVIe et la fin du XIXe siècle. Il s’inscrit dans le champ de l’histoire et de l’épistémologie des idées linguistiques. La mise en série des chapitres consacrés au temps dans les grammaires de la tradition française fait apparaître une remarquable continuité dans l’élaboration et la diffusion du savoir au cours de cette période. C’est la thèse principale défendue par ce livre, qui résulte elle-même des choix qui ont présidé à l’établissement du corpus : non pas quelques textes représentatifs des changements les plus significatifs, mais l’établissement d’une série présentant une granularité assez fine pour saisir toute la complexité des mouvements du changement. Le point de départ dont se saisissent les premiers descripteurs des langues modernes est l’appareil théorique hérité des latins, principalement celui développé par Priscien. Ce cadre initial est ensuite aménagé et complété par les grammairiens du français dans leur effort pour rendre compte des données du vernaculaire. Au sein du foisonnement impressionnant d’innovations suscité par l’exploration du champ de la sémantique verbale, la contribution de Port-Royal (1660) se distingue par sa portée. Les Messieurs réduisent en effet le modèle descriptif à un dispositif combinatoire permettant le repérage des événements dans un référentiel comportant un nombre fini de critères. Il en résulte une géométrisation de la sémantique temporelle dont les auteurs au cours des siècles suivants revendiquent le caractère formel, testent l’efficacité descriptive ou discutent la validité, jusque dans les grammaires générales les plus tardives du XIXe siècle, et au-delà chez des auteurs qui en recueillent l’héritage comme Jespersen et Reichenbach.
|

|
Priscien, Grammaire : Livres XIV, XV, XVI - Les invariables édition de Marc Baratin et Bernard Colombat, Paris, Vrin, 2013, coll.: Histoire des Doctrines de l'Antiquité Classique ; 44 328 p., ISBN 9782711625000, prix : 18.05 euros.
Le groupe Ars grammatica poursuit, avec les livres 14 à 16, la traduction, jusqu’alors inédite, de l’Ars Prisciani, somme de la grammaire antique écrite à Constantinople au début du VIe siècle. Ces livres sont consacrés aux parties du discours invariables : la préposition (livre 14), l’adverbe et son appendice l’interjection (livre 15), la conjonction (livre 16). Les problèmes linguistiques soulevés (définition, sémantisme et fonction de ces invariables) traversent toute l’histoire de la grammaire antique : Priscien en propose l’ultime version qui constituera le plus souvent le socle de la réflexion médiévale, voire de la grammaire classique. La traduction de ces livres montre dans le détail les difficultés rencontrées par le grammairien : comment classer ces formes d’invariables? comment les répartir entre les différentes catégories? quels critères employer pour justifier cette répartition? quelle langue de référence adopter? quels exemples (littéraires ou forgés) choisir? L’élaboration de cette description peut être ainsi suivie dans chacune de ses étapes et de ses dimensions – avec en arrière-plan la constante confrontation du matériel linguistique latin avec le grec : plus que tout autre en effet dans la grammaire antique, Priscien conçoit la grammaire dans une perspective de comparaison entre les deux langues.
|

|
Lallot, Jean,
Etudes sur la grammaire alexandrine, Paris,
Vrin, 2013, coll.: Textes et traditions, 392 p., ISBN
978-2-7116-2462-1
Après
avoir emprunté leur alphabet aux Phéniciens, les
Grecs ont inventé la grammaire, qui est au départ
l’art des lettres, grammata : la grammatikè
technè de Platon est la maîtrise de la lecture et de
l’écriture. Mais la grammaire élémentaire,
domaine du maître d’école (grammatistès), a
progressivement élargi ses ambitions pour devenir
l’étude savante des œuvres écrites et de
la langue (grecque) – c’est le domaine du
grammatikos. Dans le sillage des philosophes
précurseurs (Platon, Aristote, les stoïciens),
c’est en grande partie à Alexandrie que des
générations de grammairiens ont donné corps et
conféré une autonomie à la nouvelle discipline. On
peut situer chronologiquement leur activité entre le
IIIe -IIe siècle avant J.-C., époque des savants
philologues de la grande Bibliothèque – au
premier rang desquels Aristarque de Samothrace (ca
217-145) – et le IIe siècle de notre ère,
dominé par l’activité d’Apollonius
Dyscole et de son fils Hérodien. Les vingt-six études
de Jean Lallot regroupées ici éclairent sous de
multiples aspects – problématiques et
démarches, terminologie technique, théorie des
parties du discours, syntaxe – les origines et
le développement d’une discipline vouée à
devenir la première du trivium médiéval et à fournir
le socle épistémologique de la linguistique
moderne.
|
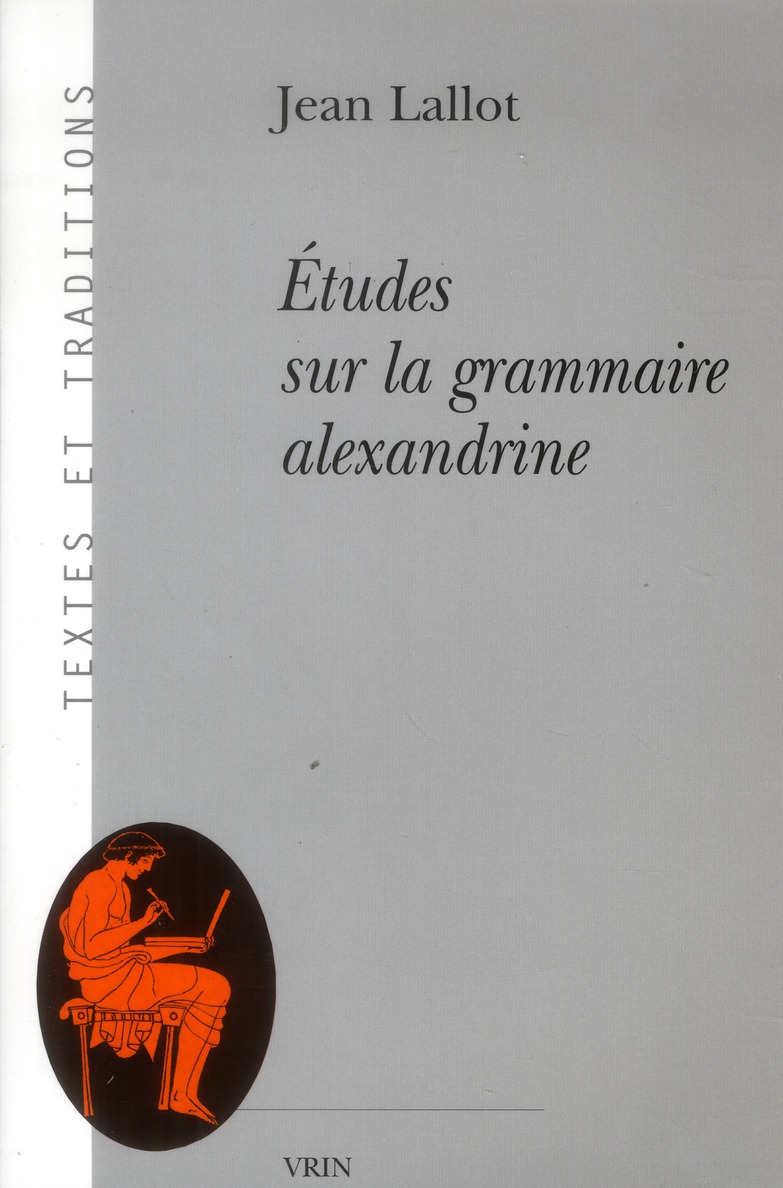 |
Archaimbault,
Sylvie & Sergueï Tchougounnikov, eds.,
Evgenij Polivanov : penser le langage au temps de
Staline, Paris, Institut d'Etudes Slaves, 2013,
ISBN 978-2-7204-0498-6, prix : 24 euros.
- Introduction, par Sylvie
Archaimbault, Sergueï Tchougounnikov 7
- V.M. Alpatov, E. D. Polivanov:
life and works 9
- Catherine DEPRETTO, Evguenij
polivanov et l’OPOJAZ 17
- Patrick Flack, Evgenij Polivanov
dans le contexte épistémologique du formalisme
russe 32
- Ekaterina Velmezova, la
linguistique d’un écrivain soviétique : E.
Polivanov dans le Faiseur de scandales de V.
Kaverin 40
- Hélène Henry, le « cercle
Polivanov » dans les années 1970 57
- Maryse Dennes, Polivanov et
Špet : la place de la phénoménologie et
l’influence de Husserl 66
- David Romand, Sergueï
Tchougounnikov : Polivanov psycholinguiste :
linguistique, psychologie et formalisme dans les
années 1910-1930 83
- Sylvie Archaimbault, E. D.
Polivanov et le langage 122
- Mika Lähteenmäki, Evgenij
Polivanov: towards a Sociological paradigm in the
Study of language 130
- Ekaterina Velmezova, E. D.
Polivanov théoricien de la didactique des langues
140
- Roger Comtet, l’héritage de
Baudouin de Courtenay et la phonologie de Polivanov
158
- Elena SImonato-Kokochkina,
Polivanov devant le « rubicon alphabétique »
179
- Svetlana Gorshenina, Polivanov en
Asie centrale : linguistique, classification des
peuples et délimitation nationale 196
- Anna Dybo, les recherches
turcologiques de Polivanov 218
- Sergueï Tchougounnikov, Polivanov
théoricien de l’évolution du langage 234
- Annexes
- Sergueï TchougounnIkov, De quoi
est fait un génie ordinaire 260
- choix de poèmes, Evgenij
Polivanov 264
- Anna Dybo, les travaux
turcologiques et altaïstiques de E. D Polivanov
274.
- Kirill Postoutenko, Evgenij
Polivanov, une pensée par systèmes poétiques
269
|

|
Colombat, Bernard,
Jean-Marie Fournier & Valérie Raby, eds.,
Vers une histoire générale de la grammaire
française, matériaux et perspectives. Actes du colloque
international de Paris (2011), Paris Honoré
Champion, 2012, 888 p., ISBN 9782745324306, prix : 98
euros.
Le
volume rassemble les actes du
colloque «Vers une histoire générale de la grammaire
française?» (janvier 2011, Université Paris Diderot) et
répond à un double objectif: – dresser un bilan
des travaux consacrés depuis une cinquantaine
d’années à l’une des traditions en
vernaculaire les plus remarquables par la quantité et
la diversité des textes et des discours qu’elle a
suscités, – articuler l’ensemble des points
de vue adoptés par les études récentes dans une
histoire générale de la grammaire du français.Les
contributions sont réparties en cinq ensembles:
méthodologie et enjeux épistémologiques, usages et
représentations, grammaire et enseignement, catégories
et concepts, questions de syntaxe.
|
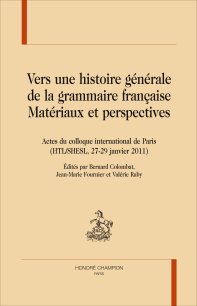 |
Baumgarten, Jean, José
Costa, Jean-Patrick Guillaume & Judith Kogel,
eds., En mémoire de Sophie
Kessler-Mesguich, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2012, 325 p., ISBN 978-2-87854-570-8, prix 23 euros.
- Avant-propos 7
- Sophie Kessler-Mesguich 11
- Hommage à Sophie Kessler-Mesguich
zal, Moshe Bar-Asher 17
- Ouverture, David Kessler, 21
- Rabbi Yehoshua ben Gamla,
organisateur de l’enseignement gratuit et
obligatoire dans la Judée du ier siècle,
René-Samuel Sirat 27
- La perception des Hasmonéens par
Flavius Josèphe, Katell Berthelot, 37
- Depuis quand certains juifs
portent-ils de longues mèches de cheveux de part et
d’autre du visage ?, Christian Julien Robin
53
- Une linguistique de théologiens,
Jean-Pierre Rothschild 77
- Le récit de la Tour de Babel :
réflexions sur le différentialisme juif et la
question de la langue, José Costa 97
- Sur Adam et Babel : Dante et
Aboulafia, Irène Rosier-Catach 115
- Le bel usage de Babel,
Sylvie-Anne Goldberg 141
- L’étude comme savoir,
l’étude comme vie, Catherine Chalier, 153
- Mots déracinés de l’hébreu
mishnique, Moshe Bar-Asher 169
- Sefer ha-Shoham (« Le Livre
d’Onyx »), dictionnaire de l’hébreu
biblique de Moïse ben Isaac ben ha-Nessiya
(Angleterre, vers 1260), Judith Olszowy-Schlanger
183
- Au confluent de deux traditions
grammaticales, le Petaḥ deḇaray,
Judith Kogel 199
- Élie Bahur Lévita, aux origines
de la tradition grammaticale de la langue yiddish,
Jean Baumgarten 215
- En vue d’une grammaire
méthodique de l’hébreu moderne, Il-Il
Malibert-Yatziv 235
- Légendes étymologiques : à propos
de quelques mots français réputés provenir de
l’hébreu (brouhaha, tohubohu, gouine,
goujat), Michel Masson 245
- Aux sources de la personne
grammaticale, Jean Lallot 269
- À propos d’un fragment du
Marāḥ al-Arwāḥ
d’Ibn Masıūd, Jean-Patrick
Guillaume 283
- Le subjonctif en arabe
classique et en français : des similarités
intéressantes, Arik Sadan 293
- Notices biographiques des auteurs Abstracts Index
des noms propres
|
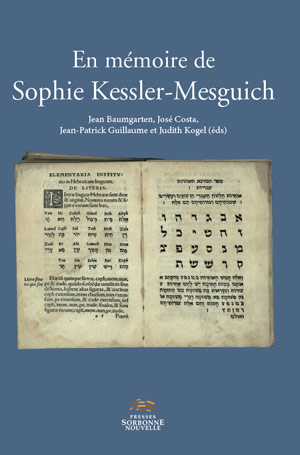
|
Fredborg, Karin Margareta,
Anne Grondeux & Irène Rosier-Catach,
Glosa Victorina super partem Prisciani De
Constructione (ms. Paris, Bibliothèque de l'Arsenal
910) Turnhout, Brepols, 2011 (paru en 2012),
coll.: Studia Artistarum 27, xxx, 97 p., ISBN
978-2-503-54097-9, prix : 75 euros.
From
the twelfth century onwards, notable advances in the
theoretical development occur in independent
treatises on syntax, which on their side are
intimately linked with medieval commentaries on the
last two books, the so-called Priscian Minor, of the
Institutiones Grammaticae I-XVIII, where Priscian
deals with syntax. A number of the independent
treatises on syntax are now available. But of the
many commentaries on Priscian Minor known, only a few
have been edited, so let me start by editing an
interesting 12th c. gloss on Priscian Minor, called
the Glosa Victorina. Priscian Minor itself begins
with introducing the notion of what is a perfect
sentence, what is a well-formed utterance and which
parts of speech are indispensable or the most
important, stating their order of importance : noun,
verb, participle, pronoun, and the indeclinable word
classes. As the argumentation unfolds, comparisons
between letters, syllables and words are introduced
providing a continuity and refinement on what was
taught earlier in the so-called Priscian Maior, and
how this concerns grammar on the level of syntax.
Very quickly, this leads to an interdisciplinary
discussion of what constitutes a perfect sentence
(according to the grammarians and the dialecticians),
involving the commentators in redefinitions of the
principal parts of speech and explaining their
distinguishing features. In this process, notions of
substance, of person, of deixis, of reference –
signification, and many other important grammatical
issues are discussed. So in principle, the beginning
of any commentary on Priscian Minor provides its
author with scope for developing his particular
doctrines and ideas of prime importance in
linguistics. Here the Glosa Victorina deserves a
closer look, because it provides us with insights
into discussions normally only hinted at by Abelard,
or a use of terminology which then becomes refined
and partially rejected by William of Conches and
Petrus Helias.
Le Grand
Corpus des grammaires françaises, des remarques et
des traités sur la langue XVe-XVIIe siècles,
Base de données textuelles sous la direction
de Bernard Colombat, Editions Classiques Garnier
Numérique, 2011
Le Grand Corpus
des grammaires françaises, des remarques et des
traités sur la langue XIVe-XVIIe siècles réunit en
une seule base de données le Corpus des grammaires
françaises de la Renaissance, le Corpus des
grammaires françaises du XVIIe siècle et le Corpus
des remarques sur la langue française (XVIIe siècle),
c’est-à-dire la quasi-totalité des grammaires
françaises du XIVe au XVIIe siècle. Chaque grammaire
se présente à la fois en version saisie, à
l’identique de l’original, et en
fac-similé. Il s’agit d’un ensemble sans
équivalent qui permet des recherches allant de la
simple consultation à la recherche universitaire la
plus aboutie, selon les attentes des chercheurs et
des étudiants. Le Grand Corpus offre la possibilité
de constituer un corpus, d’extraire et
d’exporter des résultats. Un tel ensemble
promet de renouveler la recherche dans les domaines
de l’histoire de la langue française et de
l'histoire des idées linguistiques
|


|
Dante
Alighieri,De l'éloquence en
vulgaire, Traduit du latin par Ane Grondeux,
Ruedi Imbach et Irène Rosier-Catach. Introduction et
appareil critique par Irène Rosier-Catach., Paris,
Fayard, 2011, coll.: Essais, 416 p., ISBN
9782213637983 prix : 22.50 euros.
Avant de choisir le toscan pour écrire la Comédie,
Dante a pensé l’usage du vulgaire, langue du
peuple, en l’opposant au latin, langue des
lettrés. Le Traité de l’éloquence en vulgaire
(1304), paradoxalement écrit en latin, constitue une
démonstration à la fois politique et linguistique en
faveur de ce « vulgaire illustre » indispensable à
l’unification de la nation italienne. Dante y
décrit philosophiquement le parler propre de
l’homme en tant qu’être social et
rationnel, réinvente son origine dans l’unité
de l’idiome adamique et sa diversification
après Babel, puis il construit le « vulgaire illustre
» comme l’Un devant éclairer tous les usages
multiples, et établit, à partir des pratiques
poétiques excellentes, les règles qui le gouvernent.
C’est donc en tant que théoricien politique
qu’il revendique une autorité sur la langue et
donne au poète une fonction essentielle dans la cité
des hommes. La nouvelle traduction proposée ici en
regard de la version originale s’accompagne
d’un apparat de notes qui donne pour la
première fois au lecteur français un accès à ce texte
aux facettes multiples, en prise sur les doctrines de
son temps, et d’un glossaire qui explicite la
technicité et la précision du vocabulaire utilisé par
Dante, tant en latin qu’en italien.
|
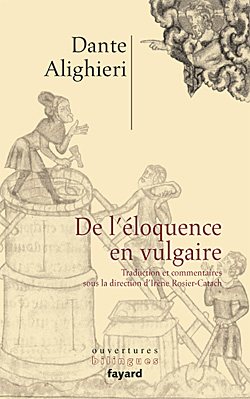
|
Rosier-Catach,
Irène, ed., Arts du langage et théologie
aux confins des XIe XIIe siècles, textes,
maîtres, débats, Turnhout, Brepols, 2011, XXVIII+810
p., ISBN 978-2-503-53518-0.
Introduction,
Rosier-Catach Irène, ix-xxviii
1.Synthèses
1.1. Guilaume de Champeaux : aspects biographiques et
intellectuels
Grondeux, Anne, Guillaume de Champeaux, Joscelin de
Soissons, Abélard et Gosvin d'Anchin : étude d'un
milieu intellectuel, 3
Miramon, Charles de, Quatre notes biographiques sur
Guillaume de Champeaux 45
Mews, Constant J., William of Champeaux, the
Foundation of Saint Victor (Easter, 1111), and the
Evolution of Abelard's Early Career, 83
1.2. Les arts du Trivium et la théologie
Grondeux, Anne, Rosier-Catach, Irène, les Glosulae
super Priscianum et leur tradition, 107
Marenbon, John, Logic at the Turn of the Twelfth
Century : a synthesis, 181
Ward John O., Fredborg, Karin Margareta, Rhetoric in
the time of William of Champeaux 219
Giraud, Cédric, la sacra pagina et les écoles du
premier XIIe siècle 235
1.3. Méthodologie
Poirel, Dominqiue, datation des textes et traitement
des recensions multiples, 249
Jacobi, Klaus, William of Champeaux. Remarks on the
tradition in the manuscripts 261
2. Contributions
Cinato, Franck Expositiones verborum : le travail
lexicographique produit sur l'Ars Prisciani du IXe
siècle à Pierre Hélie 275
Caiazzo Irne, Manegold, modernorum magister
magirstrorum, 317
Giraud, Cédric, L'école de Laon entre arts du langage
et théologie, 351
Erismann Christophe, penser le commun. Le problème de
l'universalité métaphysique aux XIe et XIIe siècles
373
Poirel Dominique, Magis proprie : la question du
langage en théologie chez Hugues de Saint-Victor
393
Brumberg Julie, les universaux dans le commentaire du
Pseudo-Raban à l'Isagoge (P3) : entre Boèce et la
théorie de l'essence matérielle 417
Fredborg Karin Margareta, Notes on the Glosulae and
its receptio nby William of Conches and Petrus Helias
453
Arlig Andrew, Early medieval solutions to some
mereological puzzles : the content and unity of the
De generibus et speciebus 485
Rodrigues, Vera Pluralité et particularisme
ontologique chez Thierry de Chartres 509
3. Dossiers
3.1. Le commentaire sur Priscien attribué à Jean Scot
Erigène
Cinato, Franck, Marginalia témoins du travail de Jean
Scot sur Priscien 537
Mainoldi Ernesto Sergio, Vox, sensus, intellectus
chez Jean Scot Erigène. Pour une focalisation des
sources possibles du débat théologico-grammatical au
XIe siècle 565
Luhtala Anneli, Eriugena on Priscian's Definitions of
the Noun and the Verb 583
3.2. Pré-vocalistes et vocalistes
Marin Christopher J., A Note on the Attribution of
the Literal Glosses in Paris, BNF lat. 13368 to Peter
Abaelard 605
Cameron Margaret, Abelard's Early Glosses : some
questions 647
Hansen Heine, In voce / in re in a late XIth century
commentary on Boethius' topics 663
Cameron Margaret, the development of early twelfth
century logic : a reconsideration 677
Ebbesen Sten, an argument is a Soul 695
Bibliographie, indices, planches.
|

|
Priscien,Grammaire,
livre XVII, Syntaxe, 1, Texte latin, traduction
introduite et annotée par le groupe Ars Grammatica,
Paris, Vrin, 2010, coll.: Histoire des doctrines de
l'antiquité classique, 352 p., ISBN 978-2-7116-2304-4
prix : 30 euros.
Le livre 17 de l’Ars de
Priscien occupe une place de premier plan parmi les
vecteurs culturels de l’Antiquité tardive. Avec
ce livre, le grammairien latin de Constantinople
inaugure l’analyse consacrée à la syntaxe.
S’emparant des travaux novateurs de la science
alexandrine sur la suntaxis, Priscien innove à son
tour en les adaptant au latin et en les intégrant à
l’ensemble de l’exposé grammatical.
L’originalité des conceptions développées dans
ce livre montre la vitalité constante de la réflexion
antique sur le langage, et la diversité de points de
vue dont est faite l’histoire de cette
réflexion. La répartition des éléments, leur
organisation, les concepts qui fondent leur analyse,
sont souvent très différents des représentations
actuelles. Mais ce livre contient aussi certains des
fondements de la syntaxe moderne. La conception de la
figure, non plus comme écart fautif ou excusé, mais
comme rouage interne de l’explication
syntaxique, donnera naissance dans la grammaire
médiévale aux figures de construction, qui sont
elles-mêmes à l’origine de la syntaxe de
l’accord; de même, la notion de transitio,
héritée mais transformée, est la source de la
transitivité des grammairiens modernes. Le groupe Ars
grammatica, qui réunit des spécialistes aux points de
vue distincts et complémentaires, latinistes,
philologues et historiens de la grammaire, ouvre dans
cette collection, avec le livre 17 qui en est comme
le sommet, la traduction de l’ensemble de
l’Ars de Priscien (groupe animé par Marc
Baratin, composé de Frédérique Biville, Guillaume
Bonnet, Bernard Colombat, Alessandro Garcea, Louis
Holtz, Séverine Issaeva, Madeleine Keller, Diane
Marchand).
|

|
Grondeux,
Anne, Glosa Super Graecismum Eberhardi
Bethuniensis, De Figuris Coloribusque
Rhetoricis, Turnhout, Brepols, 2010, 1 vol.,
coll.: CCCM 225, LII-340 p.-[5] p. de pl. p., ISBN
978-2-503-53348-3, prix : 210 euros.
Le commentaire du manuscrit
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 14746
offre un éclairage sur l’enseignement
grammatical, plus précisément celui des figures de
grammaire et de rhétorique, à l’aide du
Graecismus d’Evrard de Béthune, du XIIIe au XVe
siècle. Son édition est non seulement celle
d’un état du texte, mais aussi aperçu, dans les
apparats, sur son histoire. Le manuscrit utilisé est
en effet un témoin tardif qui synthétise des
traditions variées, reflétant ainsi la construction
par accrétion d’un savoir cumulatif : on y
retrouve l’influence lointaine de Jean de
Garlande, combinée avec celle des productions
universitaires de la Faculté des Arts, dont sont
reprises les spéculations intentionnalistes et
modistes, ainsi que l’habitude de recourir à
des prologues introductifs à l’étude du manuel,
édités en annexe.
|
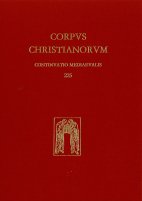
|
Archaimbault, Sylvie &
Serhii Wakoulenko, Un comparatiste avant
la lettre : Ivan Pereverzev et ses "Préceptes de la
rectitude grammaticale russe ... à l'usage des
Ukrainiens" (1782), Paris, Institut d'Etudes
Slaves, 2010, 115 p., ISBN 978-2-7204-0464-1, prix :
16 euros.
Édité en 1782, sous le règne de
Catherine II, cet ouvrage, 1;4 première grammaire du
russe à destination des Ukrainiens, se présente comme
un manuel du bon usage russe. Mais il est bien plus
que cela, à savoir une véritable comparaison des deux
langues, très fine en ce qui concerne les
particularités phonétiques du russe et de
l'ukrainien. La rareté des données relatives à la
langue ukrainienne au XVIIIe siècle en
fait une source précieuse. Par ailleurs, l'auteur
contribue à la diffusion des analyses les plus
contemporaines de la langue russe, qui se rallient à
la théorie et à la pratique grammaticales françaises
de l'époque. Ainsi
considère-t-il les caractéristiques des langues
étudiées comme un système, révélateur du « génie de
la langue ». Son auteur, Ivan Pereverzev (mort en
1794) est égaiement l'auteur d'une Description
topographique..., qui recèle maintes informations sur
la vie et les moeurs des populations ukrainiennes.
Nous proposons ici une édition critique de la
grammaire, les Préceptes élémentaires de la rectitude
grammaticale..., accompagnée de sa traduction
intégrale en regard et complétée d'un chapitre
introductif destiné a replacer l aeuvre dans son
contexte historique et linguistique, d'un appareil de
notes et d'index.
|
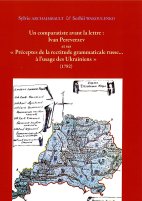
|
Colombat, Bernard, Jean-Marie Fournier &
Christian Puech, Histoire des idées sur
le langage et les langues, Paris, Klincksieck,
2010, coll.: 50 questions, 280 p., ISBN
9782252035993, prix : 18 euros.
Première partie. Les enjeux de
la rétrospection
1. « Histoire des idées sur le langage et les langues
» ou « histoire des théories linguistiques » ?
2. Que fait-on quand on fait de l'histoire des idées
linguistiques ?
3. Comment fait-on de l'histoire des idées
linguistiques ?
4. Quels usages peut-on faire de l'histoire des idées
linguistiques ?
5. Quelles ont été historiquement les réceptions de
la Grammaire Générale et Raisonnée ?
6. Quelles ont été historiquement les réceptions du
Cours de Linguistique Générale de Saussure ?
7. Quel rapport l'histoire de la linguistique
entretient-elle avec l'épistémologie ?
Deuxième partie. La dimension anthropologique des
savoirs sur la langue et le langage
8. Tous les hommes parlent mais pourquoi tous ne
sont-ils pas grammairiens ou linguistes ?
9. Existe-t-il des conditions générales
d’apparition des traditions grammaticales ?
10. En quoi consiste l’hypothèse technologique
?
11. Le seuil de l’écriture ?
12. Existe-t-il une « linguistique populaire » ?
13. Qu’est-ce qu’une représentation
mythique du langage ?
Troisième partie. Naissance des problématiques
14. Comment naît la réflexion sur le langage en Grèce
ancienne ?
15. Que nous apprennent les textes de Platon sur les
conceptions du langage dans la Grèce classique ?
16. Comment la grammaire s’est-elle séparée des
disciplines connexes (rhétorique et dialectique) et
en quoi est-elle liée à la philologie ?
17. Pourquoi nom et verbe en premier lieu ? Comment
s’est constitué l’énoncé ?
18. Comment s’est développé le schéma des
(autres) parties du discours ?
19. Comment les catégories linguistiques se
sont-elles créées, puis développées, et comment
ont-elles été nommées ?
20. Comment la grammaire a-t-elle commencé à Rome
?
21. Sous quelles formes se présentent les grammaires
les plus anciennes de la tradition occidentale ?
22. En quoi les grammaires sont-elles des objets
culturels singuliers ?
23. Comment analyser, apprendre et faire apprendre le
matériau de la langue (phonétique et morphologie)
?
24. Y a-t-il eu une syntaxe dans l’Antiquité
grécolatine ?
25. Comment les modèles syntaxiques se sont-ils
développés ?
Quatrième partie. La description des langues du
monde
26. Comment la traduction/adaptation du Donat
(grammaire latine du IVe siècle) en vint-elle à
constituer l’atelier (la fabrique) des
premières grammaires des vernaculaires ?
27. Comment les grammairiens ont-ils adapté les
concepts de la tradition gréco-latine ?
28. Quels problèmes de description les grammairiens
rencontrent-ils dans la mise en oeuvre de cet
outillage conceptuel ?
29. Pourquoi a-t-on eu l’idée de décrire et de
comparer les langues du monde ? comment s’y
est-on pris ?
30. Comment les grammairiens appréhendent-ils le
phénomène de la diversité des langues à partir de
l’expérience des grands voyages de découverte
et de l’entreprise coloniale ?
31. Pourquoi la description des langues du monde se
développe-t-elle surtout à la Renaissance ?
32. Comment la description des langues
s’articule-telle avec leur institution ?
Cinquième partie. Généralité / diversité /
historicité
33. Comment s’est posé le problème de la
généralité ?
34. Qu’y a-t-il de général dans la théorie de
l’énoncé à Port-Royal ?
35. Comment passe-t-on de la représentation de la
structure logique de la proposition à une théorie
syntaxique des fonctions ?
36. Qu’y a-t-il de général dans la théorie de
la détermination à Port-Royal ?
37. L’école a-t-elle été un agent de
disqualification de la grammaire générale ?
38. En quoi et dans quelles limites l’histoire
comparée des langues est-elle la problématique
privilégiée du XIXe siècle ?
39. Pourquoi l’apparition du terme «
linguistique » est-il contemporain du développement
de la grammaire historique et comparée ?
40. Quelles sont les grandes thématiques du siècle de
la grammaire historique et comparée ?
41. Comment est-on passé du « mot » à la comparaison
morphologique, puis aux lois phonétiques ?
42. Quels ont été les apports de la reconstruction
?
43. Dans quelle mesure et comment a-t-on renoncé à la
question de l’origine du langage et des langues
?
Sixième partie. La constitution de la linguistique
comme discipline
44. Que veut dire « général » dans linguistique
générale ?
45. Comment et pourquoi apparaissent les projets de
langues universelles ou internationales (type
espéranto) ?
46. Comment le problème de l’identification de
l’objet de la linguistique est-il posé chez
Saussure ?
47. Comment la linguistique s’est-elle imposée
comme matrice disciplinaire dans les sciences
humaines ?
48. L’objet linguistique a-t-il gardé son unité
?
Conclusion
49. Étudier les outils et les théories linguistiques
sur la longue durée est-il utile ?
50. L’historien des savoirs linguistiques
doit-il être relativiste ?
Repères chronologiques
Ouvrages utilisés et instruments bibliographiques
Sources primaires
Bibliographie secondaire
Index sélectif des notions et des termes
|
 |
Baratin, Marc,
Bernard Colombat & Louis Holtz, eds.,
Priscien : Transmission et refondation de la
grammaire, de l'antiquité aux modernes,
Turnhout, Brepols, 2009, coll.: Studia Artistarum 21,
XXII+770 p., ISBN 978-2-503-53074-1, prix : 80
euros.
Chassé d'Afrique par les
invasions vandales et installé à Constantinople au
début du 6e s., Priscien a engagé à la fin de
l'Antiquité une synthèse et une refonte de la
grammaire antique en faisant confluer ses principaux
courants, la tradition grammaticale romaine et les
apports grecs issus de la grammaire alexandrine,
auxquels il a intégré des recherches menées dans
d¹autres domaines de l'analyse de la parole, en
rhétorique et en philosophie. Cet effort d'innovation
mené dans la partie orientale de l'Empire romain
répondait au recul de la langue latine et de son
enseignement face au grec, et se présente comme une
solution pour enrayer ce recul. La création de la
première grammaire moderne en Occident est ainsi
d¹abord une entreprise de relégitimation de
l'apprentissage et de la maîtrise des codes d'analyse
de la langue, pratique culturelle largement
développée par l'Antiquité. Auteur à multiples
dimensions, chez qui se croisent les spécificités et
les ambiguïtés de l'Antiquité tardive, Priscien a été
le passeur par qui l'époque médiévale a eu
connaissance de la description linguistique complexe:
son influence a été immense durant tout le Moyen Age,
et ses échos sont perceptibles jusque dans la
tradition classique.
Malgré cela, aucune traduction dans une langue
moderne n'a encore été faite des principaux textes de
Priscien, et on commence aujourd¹hui seulement à
mesurer l'importance et l'originalité de cet
auteur.
Le présent volume est la première mise au point
d'ensemble qui lui soit consacrée, réunissant les
points de vue transversaux d'antiquisants, de
linguistes, d'historiens et de médiévistes.
Introduction IX
1. La position de Priscien
Ballaira, Guglielmo, Il Panegirico di Prisciano ad
Anastasio, 3
Bonnet, Guillaume, La géographie de Priscien, 19
2. La transmission des oeuvres : problèmes
codicologiques/ éditions/ histoire du texte
Holtz, Louis, L'émergence de l'oeuvre grammaticale de
Priscien et la chronologie de sa diffusion, 37
Ahlqvist, Anders, Deux poèmes vieil-irlandais du
Codex 904 de St-Gall, 57
Szerwiniack, Oliver, L'étude de Priscien par les
Irlandais et les Anglo-saxons durant le haut Moyen
Age, 65
Antonets, Ekaterina, Manuscripts of Priscian n
libraries of Saint Petersburg and Moscow, 77
3. L'Ars Prisciani, alias les Institutions
grammaticales : sources et ruptures
3.1. Les sources en arrière-plan : philosophie,
logique et rhétorique, 83
Ebbesen, Sten, Priscian and the Philosophers, 85
Luhtala, Anneli, Priscian's Philosophy, 109
Garcea, Alessandro, Substance et accidents dans la
grammaire de Priscien, 125
Baratin, Marc, La classification stoïcienne des
prédicats selon Priscien : un modèle de
réinterprétation, 139
3.2. Le modèle d'Apollonius et ses limites
Lallot, Jean, Entre Apollonius et Planude : Priscien
passeur, 153
Schmidhauser, Andres, Le 'De pronomine' de Priscien
et son modèle grec, 167
3.3. La relation à la tradition grammaticale et
lexicographique et ses ambiguïtés
Lomanto, Valeria, Le citazioni du Varrone in
Prisciano, 183
Bertini, Ferruccio, Riesame dei rapporti tra
Prisciano e Nonio alla luce di nuove ricerche, 197
Keller, Madeleine, Prsicien (GL3, 70.4-71.6 ;
77.7-12) et Nonius Marcellus (livre 11), 205
Cristante, Lucio, Sulle fonti comuni delle Artes
grammaticae di Marziano Capella e di Prisciano,
221
Maltby, Robert, Priscian's etymologies : sources,
function and theoretical basis : "Graeci, quibus in
omni doctrinae auctoribus ultimur", 239
4. L'Ars Prisciani, alias les Institutions
Grammaticales : le contenu
4.1. La composition interne du Priscianus maior et du
priscianus minor, et le rapport de l'un à l'autre,
247
De Nonno, Mario, Ars Prisciani Caesariensis :
problemi di tipologia e di composizione, 249
4.2. Quelques points abordés : phonétique, catégories
linguistiques, syntaxe, 279
Biville, Frédérique, la "phonétique" de Priscien,
281
Conduché, Cécile, la syllabe entre phonétique et
morphologie, 299
Calboli, Gualtiero, les modes chez Priscien (GL3,
235.16-267.5, 315
Flobert, Pierre, le chapitre de Priscien sur la voix
et la diathèse (GL 2, 373-404), 331
Swiggers, Pierre et Wouters, Alfons, l'analyse du
pronom comme catégorie morpho-sémantique, 341
Barnes, Jonathan, Quelques remarques sur la
caractérisation des connecteurs chez Priscien, 365
Pugliarello, Mariarosaria, Prisciano e la lingua
delle emozioni, 385
5. Les scripta minora ; le PS.-Priscien (De
accentibus)
Martinho, Marcos, A propos des différences entre les
Praeexercitamina de Priscien et les Progymnasmata du
Ps.-Hermogène, 395
Passalacqua, Marina et Giammona, Claudio, Lo
pseudo-priscianeo De accentibus : testo e tradizione,
411
6. La réception
6.1. Les relais et la première réception
Cinato, Franck, les gloses carolingiennes à l'Ars
Prisciani. Méthode d'analyse, 429
Grondeux, Anne, Influences de Consentius et Priscien
sur la lecture de Donat. L'exemple des res proprie
significatae (VIIe-IXe siècles), 445
Munzi, Luigi, Prisciano nell'Italia meridionale : la
Adbreviatio artis grammaticae di Orso di Benevento,
463
Goullet, Monique, Priscien dnas la lettre d'Ermenrich
d'Ellwangen à Grimald, abbé de Saint-Gall, 481
6.2. Priscien dans l'enseignement des écoles et des
universités médiévales
Rosier-Catach, Irène, Les glosulae super Priscianum :
sémantique et universaux, 489
6.3. Priscien à la Renaissance et à l'âge
classique
Lardet, Pierre, Priscien, le latin, le grec à la
Renaissance : J.-C. Scaliger et son 'De causis
linguae latinae (1540), 587
Fournier, Jean-Marie, Raby, Valérie, La sémantique du
nom dans les gramamires françaises (XVIe-XVIIe
siècles) : échos des réflexions priscianiennes,
613
Colombat, Bernard, Priscien vu par les grammairiens
de l'Encyclopédie : Du Marsais et Beauzée, 633
Conclusion
De Paolis, Paolo, Per un catalogo delle opere e dei
manoscritti grammaticali tardoantichi e
altomedievali, 653
Abréviations, Bibliographie : auteurs et textes
anciens, bibliographie secondaire
Index des auteurs anciens, des auteurs modernes, des
manuscrits, des passages de Priscien cités dans les
GL 2 et 3, des concepts et des termes.
Brumberg-Chaumont, Julie, la signification de la
substance chez Priscien et Pierre Hélie, 503
Basset, Louis, Priscien dans la grammaire grecque de
Roger Bacon, 521
Codoñer, Carmen, Species nominum en Prisciano y Juan
de Balbi, 535
Marguin-Hamon, Elsa, La présence de Priscien dans les
grammaires versifiées du premier XIIIe siècle,
557.
|
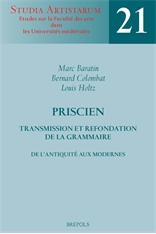 |
Büttgen, Philippe, Alain
de Libera, Marwan Rashed, Irène Rosier-Catach,
eds, Les Grecs, les Arabes et nous :
Enquête sur l'islamophobie savante, Paris,
Fayard, 2009, 374 p., ISBN 9782213651385, prix : 24
euros
La peur des Arabes et de
l’islam est entrée dans la science. On règle à
présent ses comptes avec l’Islam en se disant
sans « dette » : « nous » serions donc supposés ne
rien devoir, ou presque, au savoir arabo-musulman.
L’Occident est chrétien, proclame-t-on, et
aussi pur que possible.
Ce livre a plusieurs « affaires » récentes pour
causes occasionnelles. Occasionnelles, parce que les
auteurs, savants indignés par des contre-vérités trop
massives ou trop symptomatiques, s’appuient sur
ces débats pour remettre à plat le dossier de la
transmission arabe du savoir grec vers
l’Occident médiéval. Occasionnelles, parce que
les différentes contributions cherchent à cerner la
spécificité d’un moment, le nôtre, où
c’est aussi dans le savoir que les
Arabes sont désormais devenus gênants.
Il est donc question ici des sciences et de la
philosophie arabo-islamiques, des enjeux idéologiques
liés à l’étude de la langue arabe, de ce que «
latin » et « grec » veulent dire au Moyen Age et à la
Renaissance, de la place du judaïsme et de Byzance
dans la transmission des savoirs vers l’Europe
occidentale, du nouveau catholicisme de Benoît XVI,
de l’idée de « civilisation » chez les
historiens après Braudel, des nouveaux modes de
validation des savoirs à l’époque
d’Internet, ou de la manière dont on enseigne
aujourd’hui l’histoire de l’Islam
dans les lycées et collèges.
Il est question dans ce livre des métamorphoses de
l’islamophobie. Pour en venir à une vue plus
juste, y compris historiquement, de ce que nous
sommes : des Grecs, bien sûr, mais des Arabes aussi,
entre autres.
|
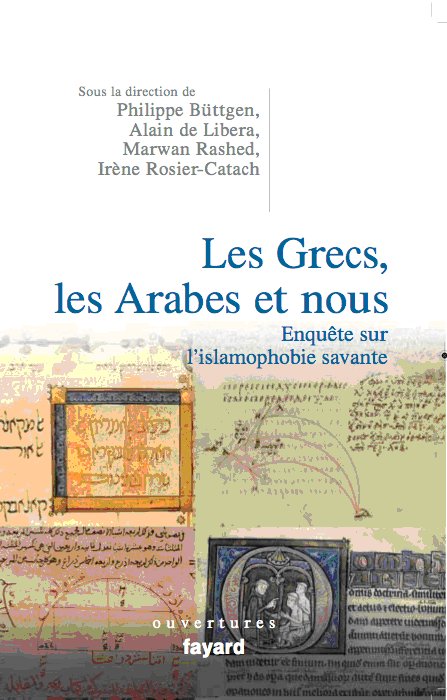 |
Gessner,
Conrad, Mithridate. Mithridates
(1555) Introduction, texte latin, traduction
française, annotation et index par Bernard
Colombat et Manfred Peters, Genève, Droz,
2009, coll.: Travaux d'Humanisme et Renaissance - 452
672 p., ISBN 978-2-600-01285-0 prix : 80
euros.
En 1555, le médecin et
botaniste zurichois Conrad Gessner eut l’idée
de rassembler les observations qu’il avait
glanées sur les langues à l’occasion de ses
nombreux travaux. Il en résulte un bref ouvrage de
quatre-vingts feuillets, au format de poche, qui
présente, selon l’ordre alphabétique, à la fois
les langues et les peuples qui les parlent, et qui
constitue l’une des premières compilations
linguistiques. Le Mithridate comporte d’assez
nombreuses citations (presque toujours explicites) et
des échantillons de langues, sous la forme notamment
de vingt-sept versions du Notre père. La présente
édition donne une introduction, puis le texte latin
et sa traduction en vis-à-vis, une abondante
annotation répartie sous les deux textes, six index
et une importante bibliographie.
|
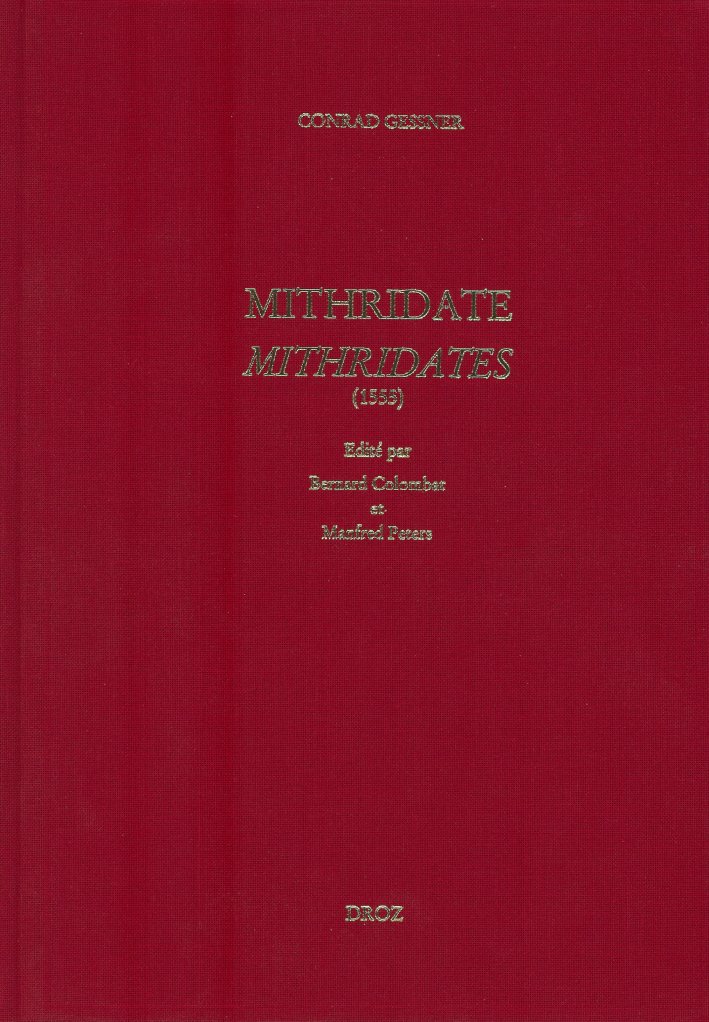 |
Bühler,
Karl, Théorie du langage,
Traduction, notes et glossaire deDidier
Samain, présentation de Janette
Friedrich, préface de Jacques
Bouveresse, Marseille, Agone, 2009, coll.:
Bancs d'essais, 687 p., ISBN 978-2-7489-0086-6, prix
: 35 euros.
« Ce qu’effectue le langage
humain est triple : expression, appel et
représentation. Le signe langagier est symptôme en
vertu de sa dépendance par rapport à
l’émetteur, dont il exprime l’intériorité
; il est signal en vertu de son appel à
l’auditeur, dont il guide le comportement
externe ou interne comme d’autres signes de
communication ; il est symbole en vertu de sa
coordination aux objets et aux états de choses. »
Paru en 1934, ce classique des sciences du langage
est aujourd’hui l’un des fondements de la
pragmatique, de la sémiotique et de la théorie de la
communication. Il se situe à un carrefour : héritage
de la linguistique allemande du XIXe siècle,
réception critique de la phénoménologie de Husserl,
proximité avec la démarche déductive de Hilbert,
lecture originale du Cours de linguistique générale
de Saussure, relations avec le cercle de Vienne et
les écrits contemporains de Wittgenstein, etc. Son
modèle des trois fonctions du langage a nourri les
travaux de Jakobson, de Popper et bien
d’autres. D’essence interdisciplinaire,
croisant étroitement psychologie et linguistique,
cette pensée retrouve son actualité avec les travaux
cognitivistes sur le langage et sur l’esprit.
Professeur à Vienne, Karl Bühler (1879-1963), qui
était aussi philosophe et psychologue, compte parmi
les fondateurs de la linguistique contemporaine.
Cette traduction inédite est accompagnée d'un
important appareil critique, dont une présentation
historique et un glossaire des principaux concepts.
|
 |
Auroux,
Sylvain, La philosophie du langage,
Paris, PUF, 2008, coll.: Que sais-je ? 1765, ISBN
978-2-13-056889-6.
On définit l'homme par le
langage et par la raison, cequi signifie que ,sans
langage, il n'y aurait pas de rationalité. La raison
et le langage peuvent-ils se confonde comme le
supposaient les projets de langue universelle ? Que
signifie alors pour la raison humaine le fait que le
langage nous soit donné sous la forme d'une
multiplicité de langues différentes ? Ainsi que ces
questions le montrent, la philosophie du langage ne
se réduit certainement pas à la philosophie des
sciences du langage. De Platon à Quine, cet ouvrage
invite à appréhender la philosophie du langage dans
son hétérogénéité afin de mieux en apprécier
l'importance au sein de la philosophie.
|
 |
Chevillard,
Jean-Luc, Companion volume to the
Cēṉāvaraiyam on Tamil morphology
and syntax. Le commentaire de
Cēṉāvaraiyarsur le
Collatikarām du Tolkāppiyam vol. 2:
English introduction, glossaire analytique,
appendices., Pondichéry, IFP / EFEO, 2008, coll.:
Indologie n° 84.2, 526 p., ISBN
9782855396699
This
companion volume to a French translation of the
Cēṉāvaraiyam, also
intended as a help to the reading of similar texts,
is part of an endeavour to document the development
of the Tamil scholarly tradition. The central part of
the book is an analytic glossary of all technical
words and phrases used by
Cēṉāvaraiyar while commenting on
the Collatikarām, a task which
required him both to describe the Tamil language and
at the same time to explain what the author of the
Tolkāppiyam had revealed about it. The
original approach chosen by Jean-Luc Chevillard, a
historian of linguistics, devotes as much attention
to metagrammatical items as to grammatical ones. The
focus is not on finding truths about language, but on
examining for itself that ancient and interesting
human rational activity: the building of grammars
|
 |
Chabrolle-Cerretini,
Anne-Marie, La vision
du monde de Wilhelm von Humboldt : Histoire d'un
concept linguistique, Lyon, ENS éditions, 2008,
148 p., ISBN 978-2-84788-109-7. prix : 21.85
euros.
SOMMAIRE
Introduction
PREMIÈRE PARTIE – HUMBOLDT ET SON ÉPOQUE : LES
ORIGINES DU CONCEPT
Chapitre 1 – L’homme, objet
d’étude
Une science de l’homme
Humboldt et l’anthropologie comparée
Chapitre 2 – Les langues : réalités de tous
les enjeux
La langue et les questions identitaires
La langue basque à la source du projet linguistique
humboldtien
L’étude des langues
DEUXIÈME PARTIE – LE CONCEPT DE VISION DU
MONDE
Chapitre 3 – Le discours de 1820
Le texte fondateur d’une pensée linguistique
qui va s’écrire jusqu’en 1835
Les premières occurrences du concept de vision du
monde
Chapitre 4 – Une approche théorique de la
diversité des langues
Le processus dynamique du langage
La langue dans des dépendances inédites
La vision du monde dans ses limites relativistes
TROISIÈME PARTIE – LES PRINCIPES D’UNE
RECHERCHE DES VISIONS DU MONDE
Chapitre 5 – Les principes organisateurs de
l’étude
La constitution du corpus
Une étude comparée des langues
Une étude de la langue et du discours solidaires
Chapitre 6 – La linguistique humboldtienne
L’étude de la structure de la langue
L’étude du caractère de la langue
Chapitre 7 – L’audience du concept de
vision du monde
Un rendez-vous manqué
Un concept éclaté et interprété
Conclusion
|
 |
Valdés, Juan de, Dialogue de la langue. Diálogo de la
lengua (1535), Présentation en version bilingue
espagnol et français. Introduction, traduction et
notes: Anne-Marie
Chabrolle-Cerretini, Paris Honoré Champion,
2008, 440 p., ISBN 9782745317223, prix : 59
euros.
Juan de Valdés
écrit le Dialogue de la langue en 1535. Dans le
contexte castillan, l'œuvre fait partie, avec
la Gramática de la lengua castellana
d'Antonio de Nebrija, des premiers écrits de la fin
du XVe-début du XVIe en matière de description de la
langue castillane. Dans le contexte roman de la
Renaissance, elle est représentative des dialogues
portant sur des questions linguistiques et prend part
aux débats sur les langues vulgaires. Ni grammaire ni
traité, le dialogue de Valdés n'en constitue pas
moins une œuvre majeure sur la langue
castillane du début du XVIe siècle.
|
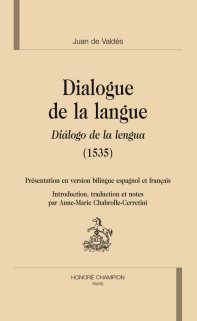 |
Auroux, Sylvain, La question de l'origine des langues,
suivi de: l'historicité des sciences, Paris,
PUF, 2007, coll.: Quadrige, essais, débats, 179 p.,
ISBN 978-2-13-056484-3
Dans cet essai, l'auteur présente une
histoire critique et une évaluation sans complaisance
du renouveau contemporain des recherches sur
l'origine des langues. L'argumentation s'appuie sur
une analyse du fonctionnement de la science moderne
qui constitue la seconde partie de
l'ouvrage
|
 |
Kouloughli,
Djamel,
Le résumé de la grammaire arabe par
Zamaḵšarī, Lyon, ENS
Editions, 2007, ISBN
978-2-84788-096-0
Zamaḵšarī,
l'un des plus grands grammairiens de langue arabe du
XIIe siècle, est l'auteur du Mufaṣṣal,
oeuvre majeure de la tradition grammaticale arabe qui
fera, des siècles durant, l'objet de nombreux
commentaires. Il est aussi l'auteur du
’Unmūḏağ, dont on trouvera
ici, pour la première fois, une version arabe
intégralement vocalisée, acompagnée d'une
transcription phonétique et d'une traduction
française abondamment commentée. Cet ouvrage
s'adresse à la fois aux arabisants cherchant une
présentation brève mais complète et systématique de
la grammaire arabe traditionnelle, et aux linguistes
et historiens de la linguistique désireux de
comprendre les mécanismes de description et d'analyse
des données linguistiques développées dans l'une des
traditions linguistiques majeures.
|
|
Kouloughli, Djamel
E., L'arabe, Paris, PUF, 2007,
coll.: Que sais-je ? 3783, 127 p.
Dernière des langues sémitiques
à être apparue sur la scène de l'histoire mondiale,
au VIIe siècle de notre ère, l'arabe, d'abord idiome
archaïque de Bédouins nomadisant dans les déserts
d'Arabie, devient, en moins de deux siècles, l'une
des langues majeures dans l'histoire de la culture
humaine. Elle sera à la fois la langue liturgique de
l'islam, en véhiculant le message coranique ; le
principal vecteur, pour de nombreux siècles, de
l'activité scientifique et philosophique, en
assimilant l'héritage des grandes cultures classiques
de l'Orient ; et le support d'une foisonnante
littérature. Aujourd'hui, elle est l'une des dix
principales langues de la planète. Cet ouvrage
présente les grandes étapes de la naissance de la
langue arabe et de son évolution jusqu'à nos
jours.
|
|
Grondeux,
Anne & Irène Rosier-Catach, La
"Sophistria" de Robertus Anglicus, Paris, Vrin,
2006, coll.: Sic et non, 412 p., ISBN
2-7116-1820-X.
détails
|
|
Chevalier,
Jean-Claude, Histoire de
la syntaxe: naissance de la notion de complément dans
la grammaire française (1530-1750), Paris,
Honoré Champion, 2006, coll.: Bibliothèque de
grammaire et de linguistique 18, 784 p., ISBN
2745311689, prix: 125 euros.
détails
|
|
Mazière,
Francine, L'analyse du discours,
Paris, Presses Universitaires de France, 2005, coll.:
Que sais-je? 3735, ISBN 2-13-054920-9, prix: 8
euros.
Détails
|
|
Garcea,
Alessandro, Cicerone in
esilio:l'epistolario e le passioni, Hildesheim,
Georg Olms, 2005, coll.: Spudasmata 103, 319 p., ISBN
3-487-12831-4, prix: 48 euros.
détails
|
|
Bally, Charles, La crise du
français: notre langue maternelle à l'école,
édition Jean-Paul Bronckart, Jean-Louis Chiss &
Christian Puech, Genève, Droz, 2004, 120 p., ISBN
2-600-00949-3.
détails
|
|
Cassin, Barbara, ed., Vocabulaire
européen des philosophies: dictionnaire des
intraduisibles, Paris, Le Seuil, Le Robert, 2004,
1532 p., ISBN 2020307308
[Plusieurs membres du laboratoire sont
auteurs d'articles du dictionnaire ; I.
Rosier-Catachest l'un des 11 responsables
scientifiques]
détails
|
|
Chevillard, Jean-Luc & Eva Wilden,
eds., South-Indian Horizons: felicitation
volume for François Gros on the occasion of his 70th
birthday, Préface: R.E. Asher & avec la
collaboration de A. Murugaiyan, Pondichéry, Institut
français de Pondichéry, Ecole française d'Extrême
Orient, 2004, Vol. 94, coll.: Publications du
département d'indologie, 651 p., ISBN
2-85539-630-1
détails
|
|
Puech, Christian,
Linguistique et partages disciplinaires à la
charnière des XIXe et XXe siècles: Victor Henry
(1850-1907), Marc Décimo, bibliographie de V.
Henry, Louvain, Peeters, 2004, Vol. 55, coll.:
Bibliothèque de l'Information Grammaticale, vi+416
p., ISBN 90-429-1420-3, prix: 60
euros.
détails
|
|
Rosier-Catach,
Irène, La parole
efficace: Signe, rituel, sacré, Paris, Seuil, 2004, coll.: Des travaux,
704 p., ISBN 2020628058, prix: 38
euros.
détails
|
|
Langue
française,La grammatisation
du français: qui que quoi vs qui(s) quod entre 16e et
17e siècles, numéro dirigé par B. Colombat, 2003,
139
détails
|
|
Auroux, Sylvain / Koerner, E.F.K. /
Niederehe, Hans-Josef / Versteegh, Kees.
History of the Language Sciences / Geschichte
der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du
langage - An International Handbook on the Evolution
of the Study of Language from the Beginnings to the
Present / Ein internationales Handbuch zur
Entwicklung der Sprachforschung von den Anfängen bis
zur Gegenwart, Berlin, New York, Walter de
Gruyter, coll. Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics
and Communication Science, vol. 18
t. 1 - 2000. LX, 1094 pages. Cloth. Euro 448, ISBN
3-11-011103-9
t. 2 - 2001.
Euro 398, ISBN 3-11-016735-2
t. 3 - 2006 http://www.degruyter.de/rs/bookSingle.cfm?id=IS-3110167360-1&fg=SK&l=E
|
|
Biard,
Joël & Irène Rosier-Catach, La tradition médiévale
des catégories (XIIe-XVe siècles), Leuven,
Peeters, 2003, ISBN 90-429-1335-5, prix : 85
€.
détails
|
|
Alvarez-Péreyre, Frank & Jean
Baumgarten, Linguistique des langues
juives et linguistique générale, Paris, CNRS
éditions, 2003, coll.: sciences du langage, 448 p.,
ISBN 2-271-06153-9, prix : 30 €.
détails
|
|
Kessler-Mesguich,
Sophie, La langue des
sages : Matériaux pour une étude linguistique de
l'hébreu de la Mishna, Paris, Louvain, Peeters,
2002, coll.: collection de la revue des études
juives, 269 p., ISBN 90-429-1191-3.
Détails
|
|
Auroux,
Sylvain, ed.,History
of Linguistics 1999 : Selected papers from the Eighth
International Conference on the History of the
Language Sciences, 14-19 september 1999, Fontenay-St.
Cloudwith
the assistance of Jocelyne Arpin, Elisabeth Lazcano,
Jacqueline Léon, Amsterdam, Philadelphia, John
Benjamins, 2003, Vol. 99, coll.: Studies in the
History of the Language Sciences, xii+403 p., ISBN 90
272 45886, prix: €135.
Détails
|
|
Auroux, Sylvain, dir.,
Histoire des idées
linguistiques, hégémonie du
comparatisme, Liège, Mardaga, 2000, tome 3, coll.
Philosophie et Langage, 594 p., ISBN 2-87009-725-5,
prix 295 F
(le tome I : "La
naissance des métalangages en Orient et en Occident"
est paru en 1989, le tome II : "Le développement de
la grammaire occidentale" est paru en 1992, chez le
même éditeur)
distribution : SOFEDIS, 11
rue Soufflot, 75005 Paris, tel 01 53 10 25 25, fax :
01 53 10 25 56
Détails
|
|
Colombat, Bernard, dir.,assisté
de Elisabeth Lazcano, «Corpus représentatif des
grammaires et des traditions linguistiques, tome II
», Histoire Epistémologie Langage, 2000,
hors-série n°3, 652 p., ISBN 2-913296-01-7, prix 145
F.
distribution : PUF
Détails
|
|
|
|

